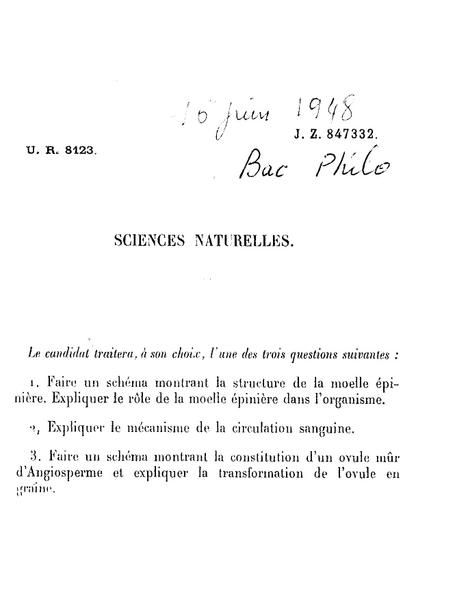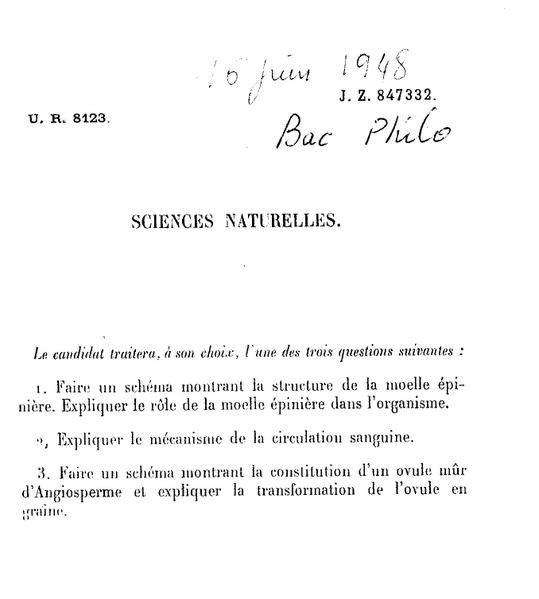Notre ami Henri-Jean Turier avait fait paraître en octobre 1996 dans la revue « Les cahiers de l’Iroise » un article dans lequel il relatait ses souvenirs du lycée de l’Harteloire. Voici, avec l’aimable autorisation de la revue, cet article.

(H-j Turier en 1950)
D’UNE RIVE À L’AUTRE
(ou les tribulations d’un pensionnaire)
C’est quelque chose de captivant que l’archéologie. On reconstitue un temple d’après quelques fragments de son architecture. Cette science s’applique à la vie.
Roger Peyrefitte
Tant que tu te souviendras, je vivrai.
Maxime inscrite au fronton de monuments aux morts
Les deux rives dont il va être question ne sont pas celles de la rivière qui sépare Brest-même de Recouvrance. Ce sont deux années inoubliables, qui ont autant compté pour le lycée que pour moi : 1948 et 1952. Le temps qui s’écoule entre ces deux repères m’a fait passer de l’enfance à l’âge adulte. Quant au lycée de Brest, il a sauté, si je puis dire, d’un établissement à l’autre. Que représente en effet 1948 dans ses annales sinon le centenaire de sa venue au monde qui coïncide à peu près avec la fin de sa première époque, celle du Vieux Brest et du Vieux lycée, celui de la rue Voltaire ? En revanche, 1952 est le début de l’ère nouvelle, celle du lycée Kérichen. Cette dernière date n’est pas, à vrai dire, l’ouverture du lycée de Kérichen mais, si j’ose m’exprimer ainsi, et que mes anciens camarades de sciences-ex me le permettent, l’année du coït fécondant qui l’a engendré, ou mieux, de la naissance de la première cellule. Ne cherchez pas : c’est la pose de la première pierre.
1948-1952. Deux cérémonies, deux repas améliorés pour les pensionnaires, deux colonnes d’une arche (comme celle de la porte Fautras), deux culées d’un pont (comme celui de l’Harteloire ) qui enjambent dans mon cas non la coulée de la Penfeld mais une tranche de vie, allant du collège de Lesneven à la faculté de Rennes : - Abrège, ton pont traverse le temps et non l’espace – dirait un élève de philo. Vieux papiers, vieilles pierres (ou vieilles pierres, vieux papiers, je ne sais plus). Lequel de nous, amis lecteurs - pour parler à la manière d’Alexandre Dumas- n’a parcouru une fois dans sa vie la série de livres où G.Lenôtre tente de faire partager le plaisir qu’il a à remonter le temps, quand après avoir fixé longuement un détour de rue, un pan de mur, un coin de cour intérieure de son Paris contemporain, il largue les amarres (pour parler à la manière d’un vétéran brestois) et met à la voile, une voile gonflée du vent de l’aventure, vers un horizon éloigné de plus d’un siècle et qui est le Paris de la Révolution ? Les “ vieux papiers ” sont du voyage. Sans aller aussi loin, j’avoue avoir la même passion : remonter le temps, de l’estuaire à la source, de la relique au saint, de la ruine au temple. Je laisse aux psychologues des profondeurs le soin d’analyser ce goût étrange pour les reconstitutions ex nihilo (à partir de rien pour les non latinistes) cette jouissance qu’on peut tirer des croisières où le rêve prend plus de place que le réel.
N’est-ce pas correct comme introduction, ô mes maîtres de 3ième, de 2ième° et de 1ère°, Mr. Tarlet, Mlle Riou, Mr. Guérin ?
Vieux papiers
J’ai mis, par hasard, il y a quelques jours, la main sur deux“ vieux papiers” qui m’ont projeté moi aussi dans le passé. Ces deux documents fragiles et précieux se trouvaient près d’un troisième moins fragile, moins précieux : une valise en bois, la valise du pensionnaire des années 50. Tous trois recouverts de la poussière d’un demi-siècle, m’ont fait sauter en un clin d’œil dans le lycée de Brest, le “lycée en baraques”. Le premier papier est un bulletin scolaire, qui me rappelle ce que mes maîtres de l’année en cours pensaient de ma valeur. “Élève studieux et craintif”. Vous voilà fixé à présent.
Le second “papier”, combien plus éloquent quoique sans appréciation, est une photographie de groupe. Nous sommes là, groupés en essaim d’abeilles autour de la reine du moment : notre professeur de philo. Nous avons consenti à distraire quelques minutes de la matière enseignée par lui pour nous immortaliser sur ce carton jauni, acceptant de bon gré cette courte escale dans notre croisière vers la terre promise toute proche : le bac . Sont alignés sur trois rangs les élèves de philo-sciences n°2 (en langage plus relevé : “sciences expérimentales”). Ceux de la rangée inférieure ont des chaises, ils ne sont pas accroupis comme le seraient des joueurs de football, témoignant par là la supériorité du cerveau sur les muscles. Les filles (en langage relevé : les jeunes filles) sont en nette majorité. Six garçons seulement, glissés comme jambon entre tartines. Il y a des chaussettes de fil blanc, il y a surtout des blouses, claires quand elles couvrent le beau sexe, masquant tout à la fois les courbes anatomiques et les différences sociales, gris sombre autrement. Deux mâles seulement ont ces blouses qu’on ne voit plus guère aujourd’hui. Les autres représentants de la gent masculine sont en tenue de ville et pour cause : ce ne sont pas des pensionnaires. Cravates bourgeoises, col roulé démocratique (un exemplaire) cheveux courts, cheveux longs (chez les jeunes filles exclusivement). Ils sont bien cachés mais il y en a, j’en suis sûr, au milieu de l’estrade et en haut, des sabots, “ socques” lisses et unies chez les hommes, “claques” à brides chez les femmes. Les porteurs de sabots sont de la maison, c’est-à dire qu’ils sont pensionnaires.
Aucun garçon ne rit, conscient sans doute, comme leur prof, de la gravité du temps qui fuit. Celui-ci courbe le front sous le poids supposé d’un joug invisible. Celui-là a l’air moins triste, mais il tourne la tête. Préfère-t-il ce profil à l’autre ? C’est égal, les minois féminins, ceux du haut surtout, sont plus gais, même celle-là qui baisse la tête et semble aussi recueillie qu’au retour de la table sainte. Bien, ce “kabig” par-dessus la blouse, seule touche de couleur locale à un tableau tout ce qu’il y a de “lycée français”. Il n’aurait pas dû bouger l’homme du centre, à moins qu’il n’ait voulu brouiller les pistes d’une identification future. Près de lui, ce regard fixe, dur et sombre, quand il se plante dans le vôtre a de quoi vous faire perdre pied. L’air goguenard de son voisin rappelle ces gens qui ne parlent que pour se payer la tête de qui les écoute. Ce n’est pas le cas de ces deux jeunes. Ont-ils vraiment leur place en Sciences-ex ? Ne seraient-ils pas mieux dans la cour des “minimes” ?
Dans la rangée des gens assis, cette jeune fille concentrée sait ce qu’elle veut et ce qu’elle ne veut pas. Sa voisine aussi, mais doit le faire savoir avec un sourire engageant, engageant celui qui lui parle à laisser fondre sa timidité. Dans l’ensemble, les visages féminins expriment douceur et sérénité. Le professeur quant à lui avec sa face blême, ascétique et racée inspire la confiance en l’avenir, au milieu de ses disciples et en avant. Tel le pétiole d’une feuille qui fait profiter de sa sève toutes les nervures, il nous a fait profiter et le fera encore pendant deux mois, de sa sagesse à raison de cinq heures par semaine. Il m’a appris autre chose : à éterniser avec élégance c’est-à-dire sans bruit.
VIEILLES PIERRES
Voilà mes vieux papiers. C’est peu. Et mes vieilles pierres ? Où sont-elles, que je puisse baser mes élucubrations sur du solide ? Que j’aie un point d’accrochage pour secouer les fantômes endormis de ce passé si lointain.
À la manière de G.Lenôtre, j’ai voulu contempler longuement, cinquante ans après, ce qui subsiste de mes chères baraques. Je crois rêver et pourtant c’est la réalité : il ne reste rien, aucune épave, aucun débris, aucun reflet matériel de ces quatre ans de jeunesse “studieuse et craintive”. Impossible de poser mon regard en 1996 sur le plus petit vestige de cet établissement. Pire qu’à Pompéi où l’on peut quand même arpenter des ruines. Mon lycée est un Atlantide, une Ys la Maudite, englouti comme ces deux chimères, corps et biens ! Reprenons notre calme. De quoi s’agit-il ? De repérer un lieu. Passe encore qu’on ait volatilisé des baraques, mais les rues, les rues qui contournaient ou traversaient mon espace lycéen. Et en effet je laisse tomber les immeubles ultramodernes qui encombrent mon champ visuel, et je cherche les noms de rues. Ouf ! Je respire et retrouve, non sans émotion, Portzmoguer, l’Observatoire, l’Harteloire, Du guesclin. Je suis en terrain connu. Les bordures de trottoirs me rassurent. Ce granite usé et poli n’appartient pas à l’urbanisme du nouveau Brest. Ces rues aux noms familiers ont tenu bon pour se montrer à moi. À défaut du tableau, j’aurai le cadre. N’abandonnons pas trop vite les recherches. Ce blockhaus à l’entrée du lycée, qu’il semblait protéger de sa masse bétonnée et sur le mur duquel se plaisaient les collégiens venus d’ailleurs, à l’issue des épreuves écrites du BEPC, à fracasser leur bouteille d’encre, ce blockhaus a-t-il été pulvérisé ? Cherchons encore. Et cet arc de triomphe planté en plein terrain vague que tous les pensionnaires du 3ième dortoir pouvaient admirer chaque matin en se brossant les dents, cet arc de triomphe, où est-il passé ? Rien du blockhaus, à plus forte raison, rien non plus de son voisin le portail d’entrée au lycée, plus exactement la barrière de bois, rustique comme celles qui ferment les clôtures des herbages à Lambézellec. Elle laissait passer à heures fixes trois fois par jour le flot des pensionnaires, mais seulement dans un sens, inverse de celui des aiguilles d’une montre. Ils venaient, bien rangés par deux, des réfectoires et, traversée la rue Portzmoguer, gagnaient sans se hâter cour de récréation et préau sous l’œil bienveillant du concierge dont la loge dominait cette barrière.
Pour le retour au bercail, ce même flot empruntait un autre passage : un perron de six marches au loin là-bas, à l’angle des rues Portzmoguer, décidément axe noble du lycée, et de l’Observatoire. Victoire ! Les maisons, une partie des maisons qui bordent cette dernière ont échappé aux ravages de la guerre et de la reconstruction. Aucun doute, ces volets blancs, ces anneaux, ces soupiraux sont des témoins rescapés de l’ordre ancien, comme le trottoir en pierres lisses. Que dis-je, le nom du bar, c’est un bar, est le même : le Printemps. Les joueurs de foot dans la cour de récréation ne se vantaient-ils pas d’envoyer le ballon par-dessus les baraques jusque “sur le toit du Printemps” ? Je me situe un peu mieux désormais : à main droite en descendant la rue Portzmoguer le lycée proprement dit, l’ensemble “instruction” dirait un lycéen moderne, c’est-à-dire les classes et les cours de jeu. À main gauche, l’ensemble “vie” alias le “ghetto des penculs” ou, plus littéraire, la “geôle de jeunesse captive”. Guerre et reconstruction ont fait table rase des deux ensembles. Quelquefois les apparences sont trompeuses. Encore une rue sans nom ou plutôt à deux noms, qui ne sont pas des noms de rues mais de places : Fautras et Mazé, ce dernier beaucoup plus connu des Brestois de “l’Immédiat Après Guerre” que l’autre. Célèbres ou non, ces deux hommes troublent ma mémoire. J’essaie en vain de faire coïncider cet espace bicéphale planté d’arbres et de voitures à l’arrêt avec la rue de mon souvenir. Elle allait du blockhaus aux casemates. Il n’y a plus ni l’un ni les autres qui étaient d’immenses salles pavées et voûtées comme des cathédrales gothiques à usage de chevaux et de sportifs. Qu’est devenue cette rue ? J’entends encore les han-deux, han-deux, les coups de sifflet et les rebonds en cascade du ballon de volley ou de “hand” qui échappaient au professeur qui, en survêtement (le seul a en avoir un) et en “petites foulées” menaient aux casemates un cortège d’élèves dont c’était l“heure de gym”, ou l’après-midi de “plein air”. C’est égal. Je me rends compte combien est ardu un pèlerinage aux sources sans sources. Quoi d’étonnant dans cette enquête sans indices que je laisse si souvent la bride sur le cou à la folle du logis. Faute de m’appuyer sur des pierres ou des papiers, je suis contraint de le faire sur des mots. En voici une vingtaine, une vingtaines de mots-clés dirait un lycéen des temps nouveaux, tous puisés dans le fichier de ma mémoire d’ancien pensionnaire, dont l’écho a réveillé des images vieilles de 50 ans. C’est un échantillon de glossaire, classé donc comme tous les glossaires par ordre alphabétique, certaines lettres étant plus fécondes que d’autres.

GLOSSAIRE PEN-CUL
A. ANESTHÉSIE (ou ÉTAT DE GRÂCE )
Période sans souffrance qui précède la prise de conscience d’un état douloureux. Je venais d’un autre établissement scolaire et me faisais une joie depuis des mois de ne plus devoir jamais y mettre les pieds. Un paradis m’ouvrait ses portes et pendant quelques jours, les quelques jours suivant la rentrée, je l’ai cru, tout était “formidable” au lycée. Au lieu de l’équipe d’enseignants en soutane, béret basque et chaussures de marche venait à moi un corps professoral aux ongles laqués, lèvres peintes et laissant un sillage chatoyant et parfumé. Le jour et la nuit ! Un autre monde ! Une nourriture de qualité à tous les repas sans comparaison avec celle du collège, où rien n’était bon. Des conditions d’hygiène et de confort mieux qu’à la maison : eau courante, toilettes, chauffage central, la modernité quoi ! Par dessus le marché, un entourage de professeurs et d’élèves tirés à quatre épingles s’exprimant dans un français du dimanche”. Par ailleurs, l’embarras du choix entre 5 ou 6 classes de troisième. Embarras, il n’y a pas d’autre mot. Je faisais du latin et du grec en quatrième. Le hasard d’un changement de classe dans la matinée du premier jour m’a fait passer à mon insu de troisième A, en troisième B. La timidité m’a empêché de le dire à qui de droit. Adieu le grec, bonjour l’espagnol !
A. AGENT
Ce n’est pas de police, ce n’est pas de ville, c’est de service. J’ai découvert l’existence de cet honorable personnel non enseignant à mon premier repas au réfectoire. Au collège, il n’y avait que des “serveurs” ou des domestiques. Au lieu des casquettes, des coiffes léonardes et cornettes de religieuses, des toques immaculées et sous les toques, une fois sur deux des“indéfrisables”, et sous les indéfrisables, des minois aussi maquillés que ceux du personnel enseignant. Aimables et souriants, ces agents, des deux sexes, roulaient des chariots porte plat, et déposaient avec grâce sur nos tables à quatre, fromage blanc, riz au gras, petite viande et autres mets plus succulents les uns que les autres. Par ailleurs, ils pouvaient faire grève, ce qui donnait un supplément de vacances et les rendaient bien sympathiques.
A. ARGOT
Toute collectivité est une franc-maçonnerie dont le langage est le premier des rites. L’argot des maçons n’est pas celui des “profs”. Un “mataf”ne parle pas comme un “biffin” ou un “marsouin”ou alors il n’est pas dans le coup ni chez les uns ni chez les autres. Des frères d’armes. Un collégien de Lesneven aurait du mal à tout entendre du langage d’un lycéen de Brest de son âge. Quelle importance après tout ! Ce qui compte c’est de comprendre ses semblables et de faire un avec eux. Le pire, c’est l’isolement, être coupé des siens comme un soldat encerclé par les ennemis. Certains mots d’argot ont une vie éphémère, d’autres durent encore. “Bahut”, “bizuth”, “pen-cul”, “navet” qui, comme on le verra dans ce glossaire est un super “pen-cul”. Vous ne savez pas ce qu’est un “pen-cul” ? Allons !
BLOUSE
Le vrai uniforme du pensionnaire imposé, nous l’avons vu, autant pour des raisons de commodité que de charité sociale : fils de notable et boursier se confondant sous la même chape de grisaille. Certains profs ne dédaignaient pas la blouse, même grise, à cause des travaux salissants auxquels les astreignaient leur discipline ou sub tuum proesidium terminal, où la devise était de tout faire gigne, attente ac devote je n’avais aucune arme pour affronter de but en blanc une vague d’anticléricalisme impitoyable et ricanant. À peu près tout ce qui était d’ »église était tourné en ridicule. Comment pouvait-on sérieusement croire à ces fictions et balivernes valables tout au plus pour célébrer correctement mariage et funérailles ? Ah ces curés capables de faire avaler n’importe quoi !
La religion n’était pas la seule à être attaquée de plein fouet, la “bretonnité” l’était aussi. Connaître le breton ? Pour un “pensio” de ces années là, était aussi mal vu. À quoi bon savoir un patois aussi inutile que le lapon et bien moins “chic” ! À la rigueur, je ne dis pas, quelques mots par ci par là en les écorchant de préférence, en s’excusant non pas de les écorcher mais de les connaître. En tout cas jamais, au grand jamais, les prononcer à la “plouc”, avec l’accent “brezonneg”. Troisième profanation : le monde de paysans. Tout se passait comme si un amalgame inconscient était fait entre “breton” et “rustique”. “Paysan endimanché” était une injure moins littéraire qu’ours mal léché, mais aussi méprisante et au même niveau que cul terreux. “Ô mes chevaux aux naseaux de velours qui portiez dans vos yeux toute la douceur du monde”, vous n’étiez que des moteurs à crottin indignes d’un pays moderne, bons tout au plus à trôner saignant ou à point au milieu de petits pois. Le cheval, c’est bien connu, donne des forces.
C. CAR
Une fois par mois au moins (le samedi), le car est un porte-bonheur, trait d’union mobile entre la geôle de jeunesse captive et la maison de la liberté et contient enclose dans ses flancs la promesse d’un dimanche pas comme les autres. La joie est dans l’attente qui s’étire entre la barrière du concierge à 16h30 et le marchepied du véhicule qui démarre à 18 heures. Entre temps, on peut acheter deux ou trois cigarettes et les fumer en toute quiétude, boire un coup de blanc, ou deux, si on a assez d’argent, bref, faire comme tout le monde. Le même car, le lundi à l’aube, sera un oiseau de mauvais augure. Entre ces deux voyages, le temps passé ne peut être que “formidable”, même s’il ne l’est pas et qu’on le tue comme on peut.
CONCIERGE
Sa loge dominait le portail d’entrée au lycée. Personnage aimé de tous les pensionnaires certainement, non seulement par son comportement de vieux soldat bourru, débonnaire et malicieux, mais parce que ses fonctions en faisaient l’intermédiaire obligé entre le monde libre et l’espace carcéral. Dépositaire des colis expédiés par les familles, receveur des mandats et des télégrammes, il accueillait chez lui les destinataires, qui n’étaient pas loin de voir en son domicile un poste avancé de la maison chère à leur cœur. Les odeurs de pot-au-feu ou de civet de lapin qui d’aventure traversaient la cloison rappelaient les temps heureux. Une autre de ses missions, sans intérêt cette fois pour les pensionnaires, était de relever les absences aux cours. On l’entendait cheminer d’une salle à l’autre, en faisant sonner le long ruban carrelé du couloir de son pilon d’invalide de guerre.
D. DIMANCHE
Journée festive, oisive et sacrée. Trois caractéristiques marquées de droite à gauche par la messe à Saint-Michel, le repas de midi amélioré et toute une journée sans blouse. Un bon dimanche est celui où la permanence du surveillant général (sur-ge en argot) n’est pas assurée par le n°1 mais par l’un des deux adjoints, ces deux hommes n’inspirant en aucune façon l’inquiétude sourde que le premier engendre par sa seule apparition. Un bon dimanche est un dimanche où le dessert sera un moka et non une pomme et où la promenade qui suit le repas se fera à la Corniche ou au Bouguen et non au stand de tir de Saint-Pierre ou à Menez-Paul, le rêve étant bien sûr d’aller au cinéma. N’importe comment, à la fin de l’étude du soir, ceux qui ne sont pas sortis auront droit au film, au match ou aux amours de ceux qui ont fait l’un ou l’autre.
H. HAND-BALL
À 7 ou à 11. En salle ou sur le terrain. On aime ou on n’aime pas. Ne Accessible ou non, ce sport d’équipe, comme tous les autres sports d’équipe, a des vertus insoupçonnées des parents d’élèves. Il ajoute des points de séduction de qui le pratique, ce qui ne fait jamais une bonne note en maths ou en composition française. Le football est bien sûr à mettre dans le même sac de sport, surtout à Brest- années 50, où tous les cœurs battaient indifféremment pour le “stade” ou l’ASB. L’auteur du glossaire sera-t-il pardonné s’il confesse qu’il a cru pendant des années que “joueur pro” voulait dire joueur promotionné ? Il avoue bien volontiers, en revanche, avoir pratiqué un foot plus à sa hauteur : pousser des pièces de monnaie sur une table.
E. EXTERNE
Élève n’ayant pas besoin de compter les jours qui le rapprochent des vacances ou dont le compte est délicieusement théorique, ne mettant ni blouse (grise), ni sabots, gardant à l’oreille toute la journée les dernières recommandations maternelles : - Pense à prendre du pain ce soir en rentrant – Mets les patins s’il te plait – À ta place, je mettrais mon écharpe, il ne fait pas chaud – Ils n’ont pas d’étude et travaillent sans doute moins bien que les pensionnaires.
H. HALLEBARDE
Arme blanche du XVI siècle, réactualisée au lycée par les “navets” (ou élèves des classes préparatoires à navale) qui s’appelaient entre eux “fistots” .Le fistot “hallebarde”était, je crois, préposé à l’entrée et à la sortie des enseignants. Le fistot“menu” était chargé, lui, d’annoncer à ses vénérables anciens ce que le lycée offrait midi et soir à leurs “insatiables appétits”. Ces “navets”étaient des “pen-culs” comme nous, donc en blouses et sabots, mais avec des avantages indéniables, dont celui d’avoir atteint, et dépassé, la terre promise, c’est-à-dire le bac. À ne pas négliger non plus, chez ces super “pen-culs” le droit de fumer au vu et au su de tous, de porter un uniforme même si celui-ci était réduit à sa plus simple expression : un calot constellé d’insignes ; le droit de chanter une fois par an des chansons paillardes lors de leur fête et de faire irruption, dans nos classes ce jour-là en une farandole endiablée. Ce qui m’étonnait le plus, cependant, c’était leur observation rituelle du salut à la marine. Dès qu’il était fait allusion à cette noble institution dans un film par exemple, au ciné-club des casemates, ils se mettaient à chuinter d’admiration. Et que d’autres traditions étranges !
M. MIXITÉ
Mixtité serait plus convenable puisque ce substantif est construit sur l’adjectif “mixte” et non “mixe”, n’est-ce-pas ? Correct ou non, le phénomène ainsi désigné plonge tout “débutant” dans un monde inconnu auquel rien ne l’a préparé, surtout quand il sort d’un établissement où les seules représentantes du beau sexe sont une poignée de religieuses et deux ou trois coiffes léonardes d’age canonique. Monde inconnu, attirant et redoutable. Attirant parce que donnant accès à une terre inexplorée ou croissent des plantes fragiles comme “tendresse”, “douceur”, “charme” qui vont nourrir ses fantasmes. Redoutable parce qu’ouvrant la porte à une compétition sourde ou déclarée entre les partenaires de l’autre genre qui chercheront à s’affirmer devant ce parterre féminin à la moquerie facile, à l’intuition qui ne trompe pas et au jugement sans appel. Les timides en sortent encore plus timides et les conquérants encore plus conquérants.
O. ODEUR
L’odeur de mon enfance était dans une pomme, a écrit un poète (lequel ?). Celle de mes quatre ans de jeunesse captive est un mélange d’essences où prédominent selon les heures et les jours du beurre rance et resté trop longtemps au soleil dans sa valise en bois, l’éther des vaccinations, le fumet du hareng-pommes à l’huile, l’aérosol anti-grippe, le goudron des planches des baraques, sans oublier, en dernière année, l’odeur chaude et aigrelette des urinoirs de la grande cour au petit matin, masqué quelques minutes par l’arôme de la première cigarette, agitée pour empêcher la fumée traîtresse de se faire voir.
T. TROUSSEAU
Un même mot pour deux choses. La première est le trousseau de lingerie, terreur des boursiers et de leurs familles. “Où vais-je trouver tout ce qu’ils demandent ? ”. Le second trousseau est celui du veilleur de nuit, l’homme de l’ombre, le Père Noël de chaque jour qui, précédé de son pinceau de lumière et du cliquetis de ses clés vient secouer le boîtier de pointage des dortoirs, mettant fin, par son intrusion, aux conciliabules sur l’oreiller, au chahut, aux sabordages mais pas aux ronflements nocturnes ou aux voluptés secrètes.
O.OBSCÈNE
“Pensez-y toujours. N’en parlez jamais” demandaient les députés revanchards après 1870 à propos du retour des provinces annexées. Personne ne demande aux “pen-culs” de parler du sexe, ni d’y penser. Et pourtant… “Ils ne pensent qu’à çà” se disent les jeunes filles rangées sagement le long des couloirs à la porte des études qui deviendront salles de cours quand les blouses grises des pensionnaires auront vidé les lieux. Elles assistent à leur sortie bruyante, à leurs allusions dirigées, à leurs chants, à leurs gestes douteux et sans façons, des façons de pensionnaires. À un moment ou l’autre du “cursus” du cycle secondaire s’éveille en chacun la puberté, inondant des organismes juvéniles qui ne savent plus où donner de la tête et où et comment jeter leur gourme et la robe prétexte. Ne reste en attendant qu’à caresser des rêves libidineux, et à multiplier pensées, propos et gestes déplacés allant de la poche percée à la poignée de mains chatouilleuse. Quand un élève normalement dissipé ne souffle mot et se tient sage comme une image, c’est qu’il lit sous le manteau un livre à faire rougir un singe tel le fameux J’irai cracher sur vos tombes, objet de scandale en 1948.
P PERNOD
À 15 jours du bac deux pernod, peut-être trois ! “Il déconne le mec” chuchotaient les “petits” en voyant rentrer titubant et rigolant un math-élem qui avait trop souvent trinqué avec son “correspondant” l’après-midi du dimanche. Le “pernod” des baraques prenait, en moins littéraire, la relève de l’absinthe et passerait le relais beaucoup plus tard aux “joints”. L’évasion procurée par la drogue du pauvre est quand même pleine d’agréments et de risques.
R. RÉVISION
Adoubement profane et sans armes du chevalier de notre temps. Cérémonie de passage où, nu comme un ver, entre une toise et une balance le “pensio” des grandes classes (en congé exceptionnel) attend que les autorités préfectorales lui disent qu’il est trois fois bon : pour les femmes, pour l’alcool, pour le service. Il restera au lauréat, de retour dans son étude, d’annoncer par sa cocarde à la boutonnière qu’il a été “pris” sous les regards admiratifs et envieux de ceux qui n’ont pas encore passé l’épreuve initiatique.
T. TABAC
Hardiesse des timides. À la griserie de la nicotine qui déferle sur le champ de la pensée, accélère les battements du cœur et décolore le visage, s’ajoute la satisfaction du plaisir partagé de bouche en bouche comme un calumet de la paix et la saveur épicée de l’interdit franchi.
V. VALISE
Ce n’était pas la “Lancel” aristocratique et coûteuse des grandes écoles, ni la besace des étudiants. La mienne, je l’ai dit, était en bois. Sa poignée, métallique, fixée non pas sur chant, mais sur couvercle comme un “Vanity case” d’élégante ou, mieux, une caisse de coiffeur à domicile.. Un cadenas la mettait à l’abri des cambrioleurs. Ma hantise n’était pas qu’on me vole son contenu, mais que glissant du filet à bagages étroit du car, elle tombe à pic sur le crâne d’un voyageur, un samedi soir ou un lundi matin. Telle qu’elle était, elle me plaisait. Chaque après-midi, j’allais à sa rencontre et la soulageais du beurre, de la confiture, de la pomme et de toutes les denrées périssables qui trompent ce mal endémique des “pensio” de tous les temps, le cafard.
T. THÉATRE
Activité artistique et culturelle, à mes yeux, la plus prestigieuse. Que ce doit être fascinant que de monter sur scène comme l’ont fait les élèves de seconde avec la Jalousie du barbouillé (Vade retro Satanas), les élèves de philo avec l’Apollon de Bellac (un acteur et une actrice s’embrassaient comme au cinéma) et les premières avec le Chapeau de paille d’Italie. C’est cette dernière qui a obtenu le plus de succès, peut-être à cause des chansons qui en faisaient une comédie musicale, la première qu’il m’a été donné d’écouter. Que j’aurais voulu être des leurs ! Que j’aurais voulu surtout être capable de faire comme un de nos profs, l’année suivante qui, seul sur scène à l’occasion de la pose de la première pierre du nouveau lycée (terre promise jamais atteinte), a composé et récité à la manière de Victor Hugo “Kérichen, Kérichen, morne plaine”.
LITANIE PROFANE
Fermons notre glossaire et revenons à nos “pen-culs”. Pourquoi ne pas prendre part à leurs activités, ne pas participer à leur vie quotidienne ? C’est une journée comme les autres, quelques heures avant la prise de photo qui les a fait passer à la postérité. Sur cette photo, vous n’avez eu droit qu’à deux blouses grises, ici je vous en offre une bonne trentaine et des trois disciplines, s’il vous plait : math, sciences et philo. La salle où je vous fais entrer, à proprement parler, est en dehors de l’enclos des pen-culs puisqu’elle est sur l’autre rive de la rue Portzmoguer. Mais comme nous sommes en période de restrictions, rien d’étonnant qu’on ait fait d’une pierre deux coups et le même local, tel le maître Jacques de Molière, a pris deux fonctions : salle de cours dans la journée, étude le soir.
Un profane n’y verrait aucune différence, pas un pensionnaire des années cinquante. Pour lui ce cube d’air limité à droite par le couloir de circulation et à gauche par la rue Portzmoguer est sa maison familiale n°2, la première, la vraie ne l’accueillant que pendant les vacances. C’est “son living-room” de rechange, l’âme de son foyer d’interne que plus tard, tout “pen-cul”, même le cheveu blanchi et la mémoire obscurci, se rappellera avec émotion : son étude !
Nous y voici, à huit heures moins le quart, un matin comme tant d’autres. Une cloison frontale nous sépare de l’étude des voisins, des “première” par le fait. Sur cette cloison, un tableau noir et, collé à ce tableau noir, grimpé sur une chaise parce qu’il n’est pas grand et en chaussons parce qu’il respecte les meubles, un élève. Il a atteint de son bras tendu le coin supérieur gauche et dessine. Dans quelques minutes, une sonnerie stridente se fera entendre signalant dans tous les couloirs qu’il est temps que se fasse la métamorphose, qu’il est temps que se vident les études et que se remplissent les salles de cours, qu’il est temps que battent en retraite toutes les blouses grises et qu’entrent en action les vrais élèves avec à leur tête les professeurs de première heure. Mais avant que ne se lève le rideau sur une longue, banale et fastidieuse journée d’enseignement secondaire au lycée de Brest, jetons (nous avons juste le temps), un coup d’œil sur les derniers instants du “foyer” des “pen-culs”. Notre dessinateur en est un, bien entendu. Petit (d’où la chaise où il se perche) cheveux bruns en brosse, Ti-borgne- c’est son nom à l’époque- n’est visible pour le moment que de dos par ses camarades dispersés dans l’étude, chacun derrière sa table de travail. Il trace avec application le contour d’un bol qui fume. Et à présent, un chiffre, deux chiffres : 23, puis des lettres. Apparemment un mot bizarre dans un lycée d’état : “saint”. C’est fait. Maintenant, tourné vers l’assistance, le bras levé comme un pion qui réclame un peu d’attention, Ti-borgne demande aux blouses grises de donner des noms de saints. Qu’à cela ne tienne : toute une bordée va lui être fournie, chaque pensionnaire semblant avoir à cœur de trouver quelque chose. Tel un meneur d’enchères, l’homme à la craie écrit ou n’écrit pas. Tout ceci dans une ambiance d’excitation et d’hilarité croissantes. La litanie s’égrène, profane bien entendu, étrangère à touts les calendriers. Saint Tiller-Saint Turon- Cincinnati- Plet- Briquet.
Ah. Ici un temps d’arrêt. Un participant aux enchères a cru bon de préciser “s’imbriquer, autrement dit s’emboîter”. Son commentaire ne rencontre qu’un sourire discret. Tous ici ont passé l’age de sucer leur porte-plume. À nouveau le chapelet laïc de se dévider : Phonie- Phorien- Surger. Cette fois, une explosion de rires salue l’heureux inventeur de la formule. “Surger”c’est mieux, beaucoup mieux qu’une allusion grivoise.. L’ovation qui a accueilli les deux syllabes n’est plus ni moins qu’un exorcisme. On conjure le mauvais sort en en riant. “Surgé” est le terme d’argot désignant le surveillant général, le surveillant général n°1, l’homme dont un seul regard suffit à imposer silence au plus audacieux non seulement de tous les “pen-culs”, mais vraisemblablement de tous les hôtes de ce lycée.
Mais de quoi parle-t-on à la fin ? On parle du temps qui passe, qui ne passe pas assez vite. 23 en lettres blanches, c’est 23 au jus. Le même langage que naguère, dans leurs chambrées, les soldats du 2ième régiment d’infanterie coloniale. Un coup d’œil sur un plan du vieux Brest (à défaut de pierres, les papiers demeurent) m’a indiqué que la caserne Fautras dressait ses hauts murs de pierres taillées là où s’étirent les barres de béton et les toitures de papier goudronné de notre lycée. Mais les bourgerons des “marsouins” de corvée ont passé le relais aux blouses pacifiques et les brodequins de marche se sont effacé devant les sabots, les sabots masculins exclusivement. Dans notre living-room, il n’y a que des “socques”, les “claques” des filles d’Eve n’ont pas droit de cité, pas plus que l’alcool ou le tabac.
CANTANDO LA PENA
Pour le moment, avec ou sans “socques”, nos garçons rient, ils rient encore de leur “surgé”. Mais le temps presse. Tout le monde se prépare à évacuer les lieux. Certains, debout ou inclinés sur leur pupitre, “débarrassent” comme en vacances on débarrasse la table de cuisine. Certains à croupetons ou à genoux, sont occupés à fourrager dans le casier du bureau. On se prépare. Cahiers, livres, classeurs sont mis en tas, un tas qui sera le viatique de s quatre heures de cours de la matinée qui feront voyager le porteur d’un prof à l’autre. Tit-Borgne se dépêche. Il a sauté au sol et rechaussé ses sabots. Le rire a cessé, mais l’ambiance reste bruyante : chaises qu’on repousse, cadenas qu’on claque, coups de genoux dans les portes des bureaux. Les fenêtres (il y en a quatre) se ferment ou s’ouvrent avec fracas. On parle fort, on s’interpelle d’une rangée à l’autre, mais surtout on chante. Pardon ! oui, on chante. Pas à l’unisson, comme en classe de musique. La symphonie n’est pas orchestrée, c’est une juxtaposition de chants individuels, chacun à son gré, chacun à sa hauteur, chacun à son rythme.. Il en résulte une extraordinaire cacophonie intense, bourdonnante et sifflante. Çà et là percent un refrain connu (Cheveux au vent, La vie en rose, Bal petit bal), une chanson paillarde (À 18 ans sur ma parole), quelques mesures de bel canto, d’opérette comme la fameuse comédie musicale, première du genre au lycée, composée et interprétée pour une soirée théâtrale par un professeur et quelques élèves de première pour agrémenter le Chapeau de paille d’Italie de Labiche : “Je n’y puis rien comprendre, pourquoi tous ces gens chez moi ?”
Bref, que ce soit Labiche ou autre chose, on chante. C’est un rite matutinal aussi important que de l’autre côté du mur, dans le couloir, les baisers sur les joues des filles rangées qui se disent bonjour en attendant la levée du rideau, aussi important que dans la cour, les bourrades et les poignées de mains viriles (avec ou sans médius chatouilleur), aussi importants que là-bas, à Lesneven, la prière du matin. Rien de tel pour entamer une “bonne” journée. “Cantando la pena, la pena se olvida” apprend-t-on en classe d’espagnol. Est-ce pour oublier la peine qu’il y a à être “pen-cul” et à subir encore 22 jours d’un temps qui n’en finit pas ?
Tout à l’heure (“Déjà ! Merde ! Fissa les gars ! Ta gueule bizuth…Museau. Doucement…) tel un vol d’hirondelles grises et volant bas, les blouses comme chaque jour, de chaque trimestre, s’en iront sans hâte excessive par les cours et les couloirs desservant les salles, se poser devant la porte de celles-ci. Ils se fondront de bonne grâce dans la masse des externes en complet veston et souliers cirés, des externes qui ne chantent pas et pour qui la perspective de je ne sais combien de jours au jus n’a guère de signification. Ne sont-ils pas chaque soir en vacances ?
Tirons le rideau sur le seuil de ces classes. Confions nos internes à leurs professeurs qui un peu partout comme chaque matin prennent possession de leur lieu de travail rendu libre. Je me souviens d’un de ces professeurs (il n’enseignait pas la philosophie) qui ne serait jamais assis à la place encore chaude d’un “pion” qui l’avait précédé dans le commun local sans observer lui aussi un rite. Non il ne chantait pas. Mais de son mouchoir plié en quatre, il essuyait soigneusement chaise et table comme s’il eut voulu les purifier. Et en hochant la tête : “Ah ces maîtres d’internat ! même pas fichus de laisser propre leur bureau ! quelle éducation !”
CONCLUSION
Cinquante ans ont passé. Cinquante ans depuis que sont sortis de leur redoute de la rue Portzmoguer nos pensionnaires, depuis que, délestés de leurs blouses et de leurs “socques” ils ont quitté le seuil de leurs classes pour courir la grande aventure de la vie. Ils se sont égaillés, sans idée de retour au bercail des “pen-culs”. La plupart d’entre eux n’ont jamais eu l’intention de revoir leur ancienne étude, pas plus que de rencontrer l’un ou l’autre de ces camarades des années studieuses.
Les marins, les marins de guerre surtout, disent souvent qu’ils préfèrent savoir leur navire bien aimé au fond de l’eau, qu’agonisant et méconnaissable dans un cimetière de vieux bateaux ; il sortira ainsi intact dans leur mémoire. Notre bâtiment de béton et de bois goudronné, lui aussi, a disparu sans laisser de traces ailleurs que dans notre souvenir0 Et c’est mieux ainsi.
Il suffit qu’une chose ait existé pour qu’elle soit éternelle. Qu’auraient-ils à se dire un demi-siècle plus tard les condisciples du ghetto des “pen-culs” ? Rien n’est comme avant. Les anciens compagnons de route, après avoir gagné la terre promise, objet de leurs vœux de candidats au bac, se sont éloignés tout doucement de la rive de leur jeunesse qui est celle de l’idéal, des espoirs et des impatiences où tout est possible parce que s’appuyant sur le roc des certitudes, et ont pris pied sur le sol mouvant du monde des adultes, découvrant que sur cette autre rive, les réalités ne concordent plus avec les rêves, que les fruits ne passent pas les promesses des fleurs et que la vie qui s’écoule se dispense de consulter les notes et les appréciations scolaires.
Adieu mon vieux lycée, englouti toi aussi comme la ville d’Ys ! Entre tes murs, j’&ai appris bien des choses et j’en ai oublié tout autant. Je sais, grâce à ces quatre années passées en ta compagnie, que la vie au-delà de la geôle de jeunesse captive n’est pas plus une croisière de tout repos qu’elle n’était en deçà de la barrière du concierge.
Tu m’as appris que l’existence est un combat et l’inquiétude le lot de chacun. Et comme tout finit par des chansons, comment résister au plaisir de redire ce couplet du Chapeau d’Italie dont les paroles ne m’ont jamais quitté depuis les matinées de première et de Sciences-ex :
Je n’y puis rien comprendre
Pourquoi tous ces gens-là chez moi
Qui viennent me surprendre
Et causer mon émoi